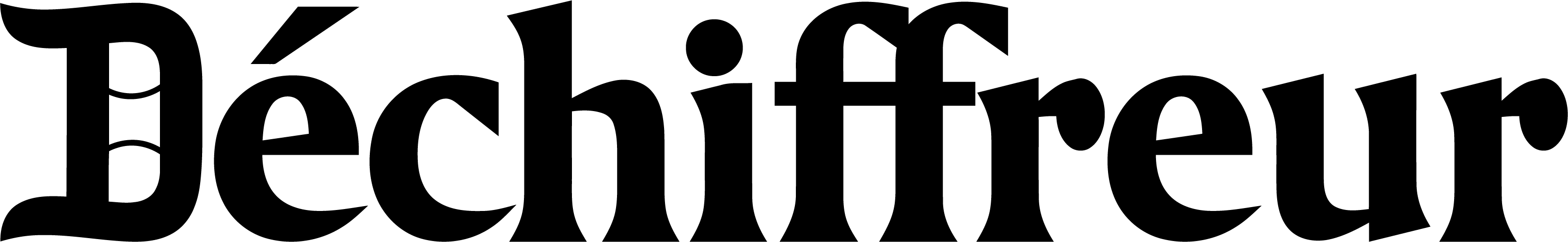La cour d’appel de Paris, saisie après la décision rendue en première instance, a confirmé la condamnation de Laetitia Avia, ex-députée de la majorité présidentielle, poursuivie pour harcèlement moral à l’encontre de plusieurs de ses collaborateurs.
Le jugement, prononcé vendredi, maintient la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de deux années d’inéligibilité, et requalifie en faute civile le traitement réservé à un sixième assistant parlementaire, pour lequel l’ex-élue avait été relaxée en première instance. À cette confirmation s’ajoute une revalorisation des dommages et intérêts que Laetitia Avia devra verser aux plaignants.
Une affaire révélée par la presse
C’est un article de Mediapart, publié en mai 2020, qui a mis en lumière les faits reprochés à la députée. Cinq anciens assistants parlementaires y dénonçaient des humiliations répétées, des propos dénigrants, et des attitudes de domination, vécus au quotidien dans leur activité au sein de l’Assemblée nationale.
Les accusations, appuyées par des témoignages circonstanciés, portaient aussi sur des remarques à caractère sexiste, raciste ou homophobe, dont la teneur, relevée dans des échanges professionnels internes, a rapidement interpellé l’opinion publique, en particulier parce que Laetitia Avia défendait alors un projet de loi contre la haine en ligne, finalement partiellement censuré par le Conseil constitutionnel quelques semaines plus tard.
Un climat de travail conflictuel et autoritaire
Lorsque le procès s’ouvre, deux ans après l’ouverture de l’enquête judiciaire en juillet 2020, ce sont sept anciens collaborateurs, tous passés par le cabinet de la députée, qui viennent décrire devant le tribunal un environnement de travail marqué par l’hostilité : un usage régulier de propos dévalorisants, des injonctions contradictoires, une pression hiérarchique forte.
Tous ne sont pas plaignants, mais leurs récits convergent. L’ancienne élue, dépeinte comme autoritaire et cassante, aurait usé de surnoms méprisants, parfois fondés sur les origines des employés. Ces éléments, jugés crédibles par la juridiction, ont renforcé le constat d’une organisation interne dysfonctionnelle, dont les conséquences humaines ont été jugées suffisamment graves pour entraîner une condamnation.