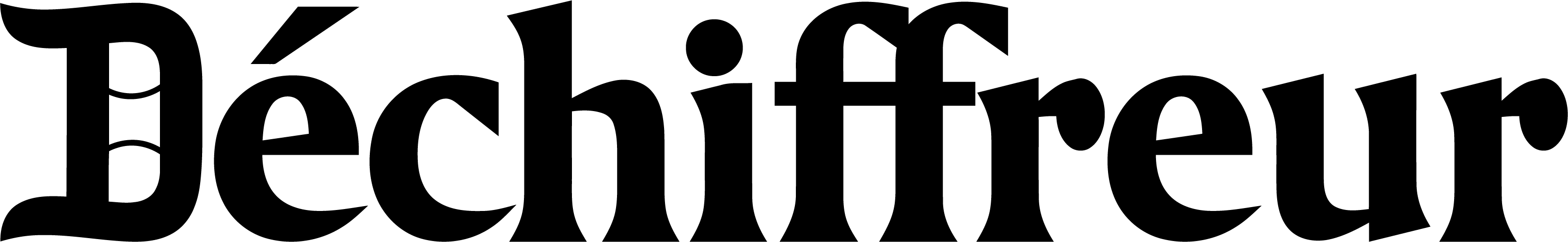Débutés en mars, les travaux de la commission d’enquête ont permis de recueillir des dizaines de témoignages, de procéder à quatre-vingts signalements au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, et d’aboutir à un document dense de 318 pages, sans compter les annexes, qui établit un diagnostic sévère : les violences subies par les enfants, dans les établissements scolaires français, ont longtemps été invisibilisées, parfois minimisées, souvent ignorées par ceux qui avaient pourtant le pouvoir d’agir.
L’affaire Notre-Dame de Bétharram
C’est autour de l’affaire Notre-Dame de Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, que la commission a concentré ses investigations. Le rapport lui consacre une quarantaine de pages, non seulement pour retracer les faits mais surtout pour montrer, à travers eux, comment les mécanismes de protection ont échoué. À travers le cas du père Carricart, accusé d’agressions sexuelles, les rapporteurs soulignent une chaîne de responsabilités défaillantes, où les autorités locales, judiciaires et éducatives ont, parfois sciemment, laissé perdurer des pratiques destructrices.
Un appel, entre un sous-directeur du ministère de la Justice et le procureur général de Pau, passé le jour même de la présentation du prêtre au juge d’instruction, a précédé sa libération. Aucun lien direct avec François Bayrou, alors président du Conseil général, n’a pu être formellement établi, mais les rapporteurs rappellent que ses fonctions lui donnaient les moyens d’agir – ce qu’il n’a pas fait.
Le silence des institutions face à la souffrance des enfants
Si la commission insiste sur les difficultés à parler qu’ont pu éprouver les victimes, dont beaucoup vivaient déjà des violences dans le cercle familial, elle insiste aussi sur un facteur déterminant : le silence prolongé, parfois volontaire, des adultes. Dans de nombreux cas, les signaux envoyés par les enfants ont été ignorés, étouffés ou disqualifiés par ceux qui étaient censés les protéger.
Quand la parole des victimes parvenait à la justice, elle se heurtait à l’inertie ou se voyait requalifiée, diluée, jusqu’à se solder par un non-lieu, un classement sans suite, ou une peine symbolique. Ce fonctionnement, les rapporteurs l’identifient comme un mécanisme de reproduction de la violence, entretenu par la structure même des institutions concernées.
Les auteurs du rapport parlent d’un « État défaillant », dans sa capacité à prévenir, signaler et sanctionner les faits. La lenteur des inspections, le manque de suivi administratif des personnels, l’absence de réactivité des rectorats, et la très faible fréquence des contrôles dans les établissements privés, en particulier ceux de l’enseignement catholique, dessinent un paysage où la surveillance réelle est restée théorique.
Les internats, souvent peu visités, sont identifiés comme des lieux à risque. Les rapporteurs constatent que l’organisation des inspections – parfois annoncées à l’avance, parfois conduites sans entretien individuel avec les élèves – limite leur efficacité.
Un ensemble de recommandations pour sortir de l’impasse
Face à ce constat, cinquante recommandations sont avancées, réparties selon cinq axes, parmi lesquels figurent la reconnaissance des victimes, l’amélioration du contrôle des personnels, la création d’un système de signalement indépendant, ou encore le renforcement de l’inspection scolaire.
Parmi les propositions figure un fonds d’indemnisation pour les victimes, une cellule nationale baptisée Signal Educ’ pour les lanceurs d’alerte, et une mission parlementaire sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur mineurs. Le rapport suggère aussi une vérification régulière des antécédents judiciaires pour tous les personnels et bénévoles, dans tous les établissements, publics comme privés.
Les établissements privés, notamment catholiques, sont pointés pour la gravité et la durée des faits relevés. Les rapporteurs évoquent un modèle éducatif rigide, souvent fondé sur l’autorité religieuse et l’internat, avec une culture du silence accentuée. C’est pourquoi ils recommandent d’harmoniser les missions de contrôle exercées sur les établissements publics et privés sous contrat, d’imposer un contrôle complet au moins tous les cinq ans, et d’intégrer dans les conventions entre l’État et ces établissements des clauses obligatoires de prévention contre les violences sexuelles.
Les seize recommandations sur les inspections visent à en faire de véritables outils de prévention. Contrôles annuels dans les internats du premier degré, entretiens individuels aléatoires avec les élèves, sanctions graduées en cas de manquements : autant de mesures qui permettraient de restaurer la confiance, de garantir un suivi, et de rompre avec les pratiques d’évitement ou de tolérance institutionnelle constatées dans certains cas.