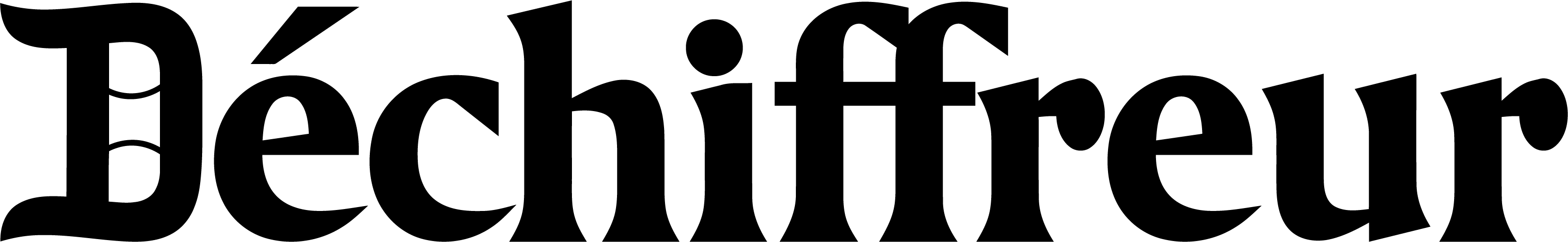Le constat dressé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son enquête Talis 2024 est sans détour. La situation des enseignants français apparaît « préoccupante ». Cette étude, réalisée tous les cinq ans, a interrogé près de 280 000 enseignants et chefs d’établissement dans 55 pays et territoires. En France, 6 000 professeurs, dont 3 766 au collège et 2 246 à l’école élémentaire, ont répondu au questionnaire.
« Il faut aujourd’hui peut-être rouvrir ce grand chantier du métier d’enseignant », a déclaré Éric Charbonnier, analyste éducation à l’OCDE, en présentant le rapport. Selon lui, les résultats soulignent une fragilité grandissante, alimentée par un manque de reconnaissance, une formation jugée insuffisante et une coopération entre collègues encore limitée.
Reconnaissance en berne et moral en recul
Les chiffres traduisent un malaise profond. Si 90 % des enseignants des pays membres de l’OCDE se disent satisfaits de leur métier, ils ne sont que 79 % en France. Un écart qui place le pays au bas du classement, aux côtés du Japon. Plus inquiétant encore, seuls 54 % des professeurs français estiment que les avantages du métier surpassent ses contraintes, le taux le plus faible de l’organisation.
Mais c’est surtout sur la reconnaissance sociale que la situation se dégrade. À peine 4 % des enseignants français jugent leur profession valorisée par la société — un chiffre divisé par deux depuis 2018 et bien en dessous de la moyenne de 20 % observée dans l’OCDE. Le sentiment d’être écouté par les décideurs politiques est tout aussi faible : seulement 4 % estiment que leur avis compte.
Des salaires jugés insuffisants et des conditions d’enseignement difficiles
La question du salaire reste au cœur du mécontentement. En France, seuls 27 % des professeurs de collège et 22 % des enseignants du primaire se disent satisfaits de leur rémunération, contre 40 % dans l’ensemble de l’OCDE.
À cela s’ajoutent des conditions de travail souvent jugées pénibles. Huit enseignants français sur dix affirment devoir gérer des problèmes de discipline récurrents dans leurs classes, soit un taux supérieur à la moyenne internationale. Près d’un cinquième du temps scolaire,18 %, est consacré à la gestion de ces incidents, au détriment de l’enseignement.
Les classes se sont également diversifiées : la part d’écoles accueillant au moins 10 % d’élèves à besoins éducatifs particuliers est passée de 42 % à 74 % entre 2018 et 2024. Dans le même temps, la proportion d’établissements comptant au moins 1 % d’élèves réfugiés est montée de 44 % à 65 %. Les enseignants doivent donc composer avec une hétérogénéité grandissante, sans toujours disposer des moyens adaptés.
Un stress en hausse et une formation jugée insuffisante
La fatigue s’installe. D’après le rapport, 18 % des enseignants français déclarent ressentir un fort niveau de stress, contre 11 % en 2018. Parmi les principales causes figurent la lourdeur administrative, la gestion du comportement des élèves et la nécessité d’adapter sans cesse les leçons aux besoins particuliers.
Le manque de préparation initiale aggrave ce ressenti. À peine la moitié des enseignants de collège (50 %) et un tiers de ceux du primaire (34 %) estiment avoir été bien formés à la pratique pédagogique. Ces chiffres placent la France en dessous de la moyenne des pays de l’OCDE.
Éric Charbonnier souligne à ce propos : « On a vraiment des défaillances sur ces questions-là ». Il estime que la réforme ramenant le concours d’enseignement au niveau bac +3 pourrait renforcer l’attractivité du métier, à condition que la formation soit réellement efficace.
Le rapport met aussi en lumière un retard dans la formation continue : seuls 9 % des enseignants français ont été formés à l’intelligence artificielle au cours des douze derniers mois, un thème pourtant incontournable dans l’éducation contemporaine.
Un travail d’équipe limité, frein à l’innovation pédagogique
L’un des points les plus préoccupants concerne la coopération entre enseignants. En France, ils consacrent en moyenne deux heures par semaine à un travail collectif formel, contre trois dans l’ensemble de l’OCDE, et jusqu’à cinq heures dans certains pays nordiques.
Cette faiblesse limite la diffusion des bonnes pratiques et entrave la création de projets pédagogiques communs. L’OCDE insiste sur la nécessité de renforcer la culture de collaboration, qui contribue non seulement à l’efficacité du système éducatif, mais aussi au bien-être des enseignants.
Repenser l’attractivité du métier d’enseignant
Au-delà des chiffres, le rapport Talis 2024 sonne comme un avertissement pour le système éducatif français. L’organisation appelle à une réflexion globale sur le statut, la reconnaissance et la formation des enseignants. Valoriser le métier, renforcer les moyens de formation, améliorer les salaires et encourager la coopération entre pairs apparaissent comme les leviers prioritaires. « La qualité du système éducatif dépend directement du bien-être et de la reconnaissance de ses enseignants », rappelle Éric Charbonnier. L’OCDE invite ainsi la France à faire de la revalorisation du métier une urgence nationale.