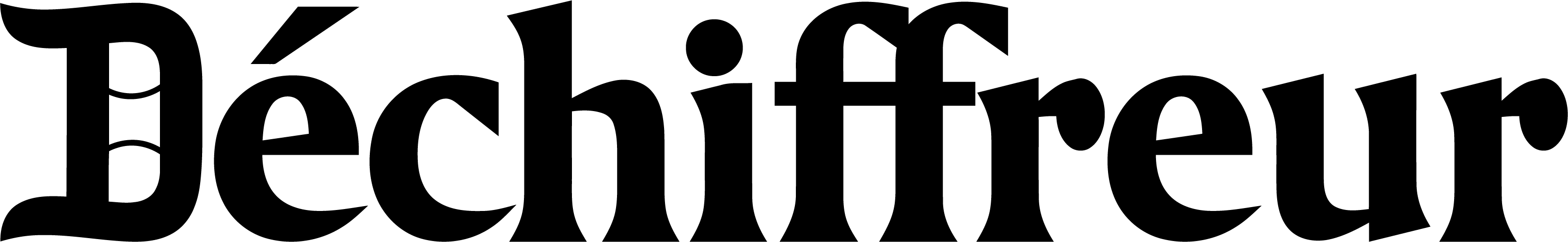La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu jeudi un arrêt qui engage directement la responsabilité de la France, estimant que les autorités n’ont pas suffisamment protégé le droit au consentement et n’ont pas mené d’enquête complète sur les faits dénoncés par une salariée hospitalière.
Selon les juges de Strasbourg, la France a « manqué à ses obligations positives », à savoir garantir des dispositions claires permettant de sanctionner les actes sexuels non consentis et veiller à leur application effective. Cette carence constitue une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibent la torture et assurent le respect de la vie privée.
L’État a été condamné à verser 20.000 euros pour dommage moral et 1.503,77 euros au titre des frais de justice à la plaignante, désignée par ses initiales E.A.
Une relation placée sous autorité hiérarchique
L’affaire trouve son origine en 2010 à l’hôpital de Briey, en Meurthe-et-Moselle, où E.A., née en 1983, travaillait comme préparatrice en pharmacie. Elle avait alors entamé une relation sadomasochiste avec son supérieur, chef de service né en 1967, identifié sous les initiales K.B.
Trois ans plus tard, la plaignante dépose plainte pour viol aggravé, violences physiques et psychologiques, harcèlement et agression sexuels. Le pharmacien est reconnu coupable en première instance pour violences et harcèlement sexuel, mais la cour d’appel de Nancy l’acquitte en 2021, considérant que la relation était consentie au motif qu’un contrat « maître/chienne » avait été signé entre les deux protagonistes.
C’est après avoir épuisé tous les recours en France que la plaignante a porté l’affaire devant la CEDH.
Les manquements relevés par la Cour européenne
Dans son arrêt, la CEDH souligne non seulement les insuffisances du cadre juridique français mais aussi plusieurs défaillances procédurales : absence de prise en compte de certains faits dénoncés, investigations jugées incomplètes, durée excessive de la procédure et appréciation contestable du consentement.
Les juges rappellent que « le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances ». Ils précisent qu’aucun engagement antérieur, même écrit, ne peut constituer un consentement valable pour un acte sexuel ultérieur, puisque ce consentement est par nature révocable.
Une procédure vécue comme une « mise au pilori »
La juridiction européenne a également retenu que la plaignante avait subi une « victimisation secondaire », se sentant elle-même placée en position d’accusée lors de l’audience d’appel.
L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), partie civile dans le dossier, a dénoncé une audience « cauchemardesque ». Sa juriste, Nina Bonhomme Janotto, décrit une atmosphère assimilable à une mise au pilori, marquée par des propos culpabilisants et stigmatisants.
Pour l’avocate de la plaignante, Me Marjolaine Vignola, cette condamnation pourrait encourager le gouvernement à renforcer la législation et à pousser les juridictions à en améliorer l’interprétation.