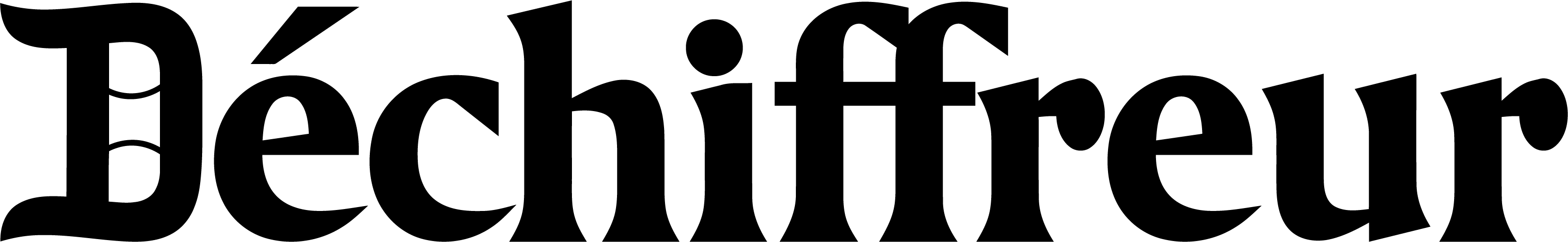Le 2 juillet 2025, le tribunal de Bobigny a condamné trois anciens cadres d’Ubisoft pour des faits de harcèlement moral, harcèlement sexuel et tentative d’agression sexuelle. Ce verdict marque une étape dans une affaire révélée par une série de témoignages publiés à partir de 2020, d’abord de manière anonyme sur Twitter, puis détaillés dans plusieurs enquêtes journalistiques, notamment celles menées par Libération et Numérama, qui ont décrit une culture d’entreprise profondément dégradée au sein de l’un des fleurons du jeu vidéo français.
Parmi les condamnés, Thomas François, ex-vice-président éditorial, a écopé de la peine la plus lourde : trois ans de prison avec sursis et une amende de 30 000 euros. Il a été reconnu coupable de harcèlement sexuel, de harcèlement moral et de tentative d’agression sexuelle, pour des faits répétés sur plusieurs années, perpétrés notamment dans les locaux de l’entreprise à Montreuil, en open space, sous les yeux de collègues et dans un silence organisationnel durable. Il a présenté des excuses lors de l’audience, affirmant ne pas avoir été l’instigateur d’un système qu’il a attribué à la « culture Ubisoft », une ligne de défense rejetée par le ministère public, qui a qualifié les faits de “violents, intenses, systématiques”, impliquant de nombreuses victimes et s’inscrivant sur la durée.
Une ambiance toxique révélée par les salariés eux-mêmes
C’est une vague de récits partagés par d’anciens salariés sur les réseaux sociaux, principalement via la plateforme X (anciennement Twitter), qui a servi de point de départ aux investigations. Très vite relayées par des journalistes, ces voix ont mis au jour des comportements de harcèlement banalisés, dans un environnement où l’humiliation, les propos sexistes et la domination managériale prenaient souvent le pas sur les règles internes et les mécanismes d’alerte. Le service éditorial, au cœur du dispositif créatif d’Ubisoft, était décrit comme structuré autour de rapports de force permanents, où la parole des victimes était minimisée, parfois ignorée, et où la hiérarchie n’intervenait qu’en cas de débordement manifeste, sans jamais remettre en cause le système lui-même.
Des condamnations individuelles, mais une responsabilité collective évitée
Outre Thomas François, deux autres cadres ont été reconnus coupables : Serge Hascoët, longtemps considéré comme le bras droit du PDG Yves Guillemot, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende pour harcèlement moral et complicité de harcèlement sexuel, tandis que Guillaume Patrux, également cadre éditorial, a reçu une peine d’un an avec sursis et une amende de 10 000 euros.
Aucune poursuite n’a été engagée contre Ubisoft en tant qu’entreprise, ni contre ses dirigeants actuels, ce que regrettent plusieurs parties civiles, qui soulignent que des alertes internes avaient été émises depuis des années sans qu’aucune mesure structurelle ne soit prise. Ni Yves Guillemot, PDG, ni la directrice des ressources humaines Marie Derain n’ont été inquiétés dans ce dossier. Cette absence de responsabilité au niveau institutionnel interroge, selon les avocats des victimes, sur la capacité du droit actuel à saisir les formes systémiques de harcèlement en entreprise, et sur la manière dont les directions peuvent continuer à esquiver les sanctions alors même que l’environnement incriminé dépendait directement de leurs choix et de leurs arbitrages.
Un signal pour le monde du travail
Pour Me Maude Beckers, avocate des plaignants, cette décision représente « une très bonne décision, aujourd’hui et pour la suite », car elle vient poser un principe clair : les pratiques managériales toxiques ne peuvent plus être ignorées ou tolérées, et les responsables doivent être sanctionnés. Selon elle, ce jugement s’adresse à toutes les entreprises, pas uniquement à Ubisoft, et pourrait encourager d’autres victimes à briser le silence.
L’audience de juin dernier, au cours de laquelle les anciens salariés ont livré leurs témoignages, a mis en lumière non seulement des comportements individuels graves mais aussi une organisation du travail où l’impunité, les jeux d’influence et la peur régnaient. Le tribunal a souligné le caractère structuré du harcèlement observé, ce qui pourrait renforcer à l’avenir les dossiers similaires, en particulier ceux où la frontière entre responsabilité personnelle et faute d’entreprise reste floue.