À l’origine, quelques appels diffusés en juillet sur Facebook et Telegram, relayés notamment par Jérôme Rodrigues, figure des Gilets jaunes. Rapidement, des centaines de groupes locaux ont vu le jour sur les messageries cryptées et les réseaux sociaux.
Selon un sondage cité par la fondation Jean Jaurès, 63 % des Français disent soutenir «Bloquons tout». Le soutien est particulièrement marqué chez les sympathisants de La France insoumise (73 %), des écologistes (67 %) et du Parti socialiste (61 %). En revanche, les électeurs de la majorité présidentielle et des Républicains . . .
Cet article est réservé aux abonnés.
Profitez de l'offre découverte à 1€
Connectez-vous
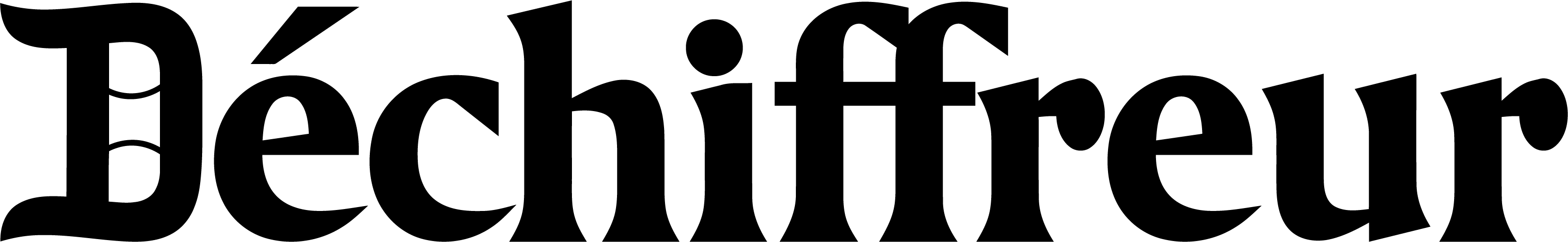
 Article réservé aux abonnés
Article réservé aux abonnés
