En 2019, à Creil, dans l’Oise, Shaïna Hansye est morte à l’âge de 15 ans dans des circonstances tragiques. Cette adolescente, alors enceinte, avait déjà traversé plusieurs épisodes de violences avant d’être tuée. Son histoire fait écho aux difficultés rencontrées par certaines victimes mineures pour obtenir une protection et une reconnaissance de leur parole.
Dès son entrée dans l’adolescence, Shaïna a connu une série d’agressions. À 13 ans, elle a . . .
Cet article est réservé aux abonnés.
Profitez de l'offre découverte à 1€
Connectez-vous
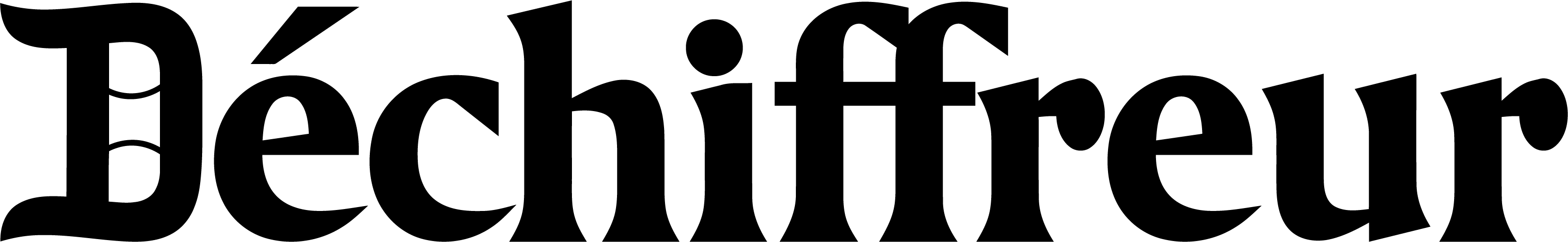
 Article réservé aux abonnés
Article réservé aux abonnés
